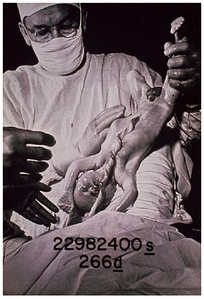Shirley Clarke - The cool world
 Précédemment on a vu le contexte politique, puis on s’est arrêté sur la guerre franco-prussienne.
Précédemment on a vu le contexte politique, puis on s’est arrêté sur la guerre franco-prussienne.
On s’inquiète. On est en septembre 1870. Les troupes prussiennes marchent vers nous. La République, proclamée le 4 septembre, n’y peut mais. Pas plus que l’Empire. On croit suivre leur parcours. On estime, on calcule, on mesure. Dans combien de temps gagneront-elles Paris ? Par où ? Est-ce une question de semaines ? De jours ? Un corps passe par la route de Soissons, un autre par celle de Meaux, un dernier par Melun[1]. Melun, Meaux, c’est tellement proche. Ne peut-on vraiment rien faire ? Attendre ? Rien d’autre ?
Le 18 septembre, les troupes prussiennes « passent la Seine à Villeneuve-Saint-Georges » [2] et arrivent aux environs de Châtillon en se massant dans les bois de Verrières. D’autres corps passent par Écouen, Pontoise[3]. On est dimanche. « Les théâtres et concerts ouvrent comme d’habitude »[4], « les femmes sont en grandes toilettes », on rit, on chante, on danse… On sera allé déambuler aux Tuileries, aux bois… Certains auront poussé jusqu’à Saint-Ouen pour leur « tour de promenade régulier le dimanche »[5]… Et pourtant. Il y a cette pensée qui tracasse l’esprit, taquine le corps. C’est peut-être la dernière fois qu’on s’amuse avant… On ne termine pas la phrase. Les pensées ne sont pas faites pour être finies de toutes façons. On regarde Paris encore, son fleuve ; ses immeubles trop récents pour qu’on s’y habitue tout à fait ; et ses foules, ces gens, élégants toujours, mais qui n’oublient pas de négliger quelque chose dans leur façon assez pour avoir l’air d’être beaux par accident, sans effort aucun. On écoute leurs rires, leurs rumeurs, leurs éclats. On entend une dame esclaffer quelque chose qui sonne comme de l’ironie en observant les passants : « heureux pays, qui passe si allégrement du grave au doux, du noir sinistre au rose tendre ! »[6]. On la regarde. Elle rit, elle aussi, comme les autres. On se promène encore sur les quais. Sur le pont des Arts, on s’arrête. On regarde le soir disperser, étouffer la lumière du jour. Les nuages avancent comme autant de menaces. On marche encore. « Les cafés sont combles »[7]. On sourit. Le lendemain, lundi, les nouvelles tombent et affaissent leur poids sur Paris : « de tous côtés le cercle allemand nous étreint. – Le siège commence. »[8] [je voulais qualifier le poids de sur, de… je ne trouve pas le substantif… disons du moyen néerlandais « suur », aigre, mais avec le sur du latin « super », ça donnait « leurs poids sur sur »…].
[noter que la progression des troupes prussiennes voisine et qu’on ne sait pas arrêter un jour comme début du siège, c’est-à-dire un événement précis qui marquerait un début… Jacques-Henry Paradis, dans ses carnets, le fait courir entre le 15 et le 20… On s’accorde sur le 18 septembre 1870…].
Le poids des nouvelles, on peut le sentir frapper le diaphragme, la gorge, le ventre. On ne sait pas s’en débarrasser. Le siège pourrait être court. Certains ne croient pas que la résistance des parisiens puisse durer. On parle d’armistice. On ne sait rien. La Ville placarde des affiches invitant à faire des provisions[9]. On les lit. On se dit qu’eux non plus ne savent rien. Les gens qu’on croise parlent de leurs prévisions, certains disent qu’on tiendra quinze jours, d’autres trois mois[10]. Ils parlent de la même façon qu’on parlait du temps jusqu’ici, avec cet air qu’on a quand la parole n’a pas d’importance, qu’on la prononce simplement comme on sourit, par politesse. Personne ne sait dire que le siège courra jusqu’au cessez-le feu du 26 janvier 1871 ; la poursuite des négociations de Paix en février ; et le défilé des troupes prussiennes sur les Champs-Élysées, le 1er mars… Et même si on devine que l’isolement va sembler long, rude, féroce, personne ne sait tout à fait comme le froid, la faim, la colère viendront changer la figure de Paris.
[S’attarder sur cette vie au jour le jour qu’on néglige d’habitude alors qu’elle permet de pressentir concrètement les tensions entre les forces politiques à Paris.]
[Commencer par dessiner la vie quotidienne du siège… le folklore de la chose… par exemple dès la fin septembre on ne se promène plus[11] ; le bois de Boulogne est fermé[12] ; le jardin du Luxembourg est interdit aux promeneurs, on y parque moutons et canons[13] ; les cafetiers et les marchands de vin ferment, par ordonnance, à dix heures et demie du soir[14] ; des théâtres (de la Porte Saint Martin, le Français, l’Odéon, le Théâtre lyrique…) se transforment en ambulances[15] ; on réquisitionne les chevaux, les voitures[16]… ; pour le courrier, on élance dans les airs des ballons « emportant 300 kilogrammes de dépêches » et « trente pigeons »[17] afin de contourner le blocus des Prussiens ; on tente de jeter des bouteilles à la rivière pour correspondre, mais la tentative est peu concluante : « Cette bouteille, suivant la date de la lettre, a mis un mois et un jour pour arriver à destination. »[18] ; on fait le tour de Paris, « le seul voyage qui nous soit permis »[19] en guise de promenade ou on va jusqu’à Saint-Cloud, « notre extrême frontière »[20] ; on admire, le 25 octobre, une aurore boréale envelopper le ciel de Paris : « Beaucoup de personnes crurent à un immense incendie. »[21] ; on mange les poissons pêchés dans la Marne et dans les lacs des Bois de Vincennes et de Boulogne : « Les prix sont des plus raisonnables. »[22] ; on coupe des arbres dans les bois de Boulogne et de Vincennes mais les bois « sont naturellement verts et ne peuvent brûler… »[23]…]
Au début du siège, on ne doute pas qu’on aura assez de vivres pour tenir[24], il n’y a qu’à voir ces immenses troupeaux aller, en un mouvement qui fait plaisir à voir, boire aux abreuvoirs de la Seine[25]. On regarde les bêtes, on vérifie qu’elles sont bien portantes, on se rassure… Certains quartiers semblent transformés en une immense ferme où les poules errent dans les rues[26]… On mange plus de cheval qu’avant[27] ; les voisins ont vendu le leur à la boucherie[28], leur voiture avait été réquisitionnée de toutes façons… On mange aussi les poissons de la Seine[29], des lacs des bois de Boulogne et Vincennes[30].
Mais déjà, on commence à avoir du mal à trouver du lait, du beurre[31] ; les marchands n’ont presque plus de sucre[32] ; les pommes de terre ont complètement disparu[33]… Comme c’est étrange de voir les marchés au trois quart désertés, la poissonnière vendre des nèfles ou la fruitière du saucisson[34]…
On a trouvé une petite boîte qui servira à rassembler les bons d’alimentation et les bons de pain… Et le rationnement est sévère, les portions de pain sont peu copieuses[35], au point qu’il faille venir avec son pain au restaurant ou chez les amis qui invitent à dîner… On le trouve « gris bleuâtre », « jaune terreux », « gris », selon les farines dont il est fait[36], chez des boulangers dévalisés, obligés de fermer à midi[37].
« Tous les animaux de Paris y passent », même les moineaux, les pigeons[38]… On livre les animaux du Jardin d’Acclimatation à l’alimentation, sauf « les chameaux et les éléphants »[39]. [ à noter que Pollux et Castor, les deux éléphants du Jardin des Plantes, ont été tués d’après Frank Schloesser[40]. Les bons morceaux se vendaient 45 francs le demi-kilo.]
[notes : s’arrêter sur la question de savoir si on mangeait ou non du rat, du chien, du chat. Jacques-Henry Paradis, qui tient bon nombre de ses informations de la lecture de la presse de droite, écrit le 11 novembre : « Les rats, commencent, paraît-il, à être fort appréciés. La chasse est ouverte, et, hier matin, un véritable marché aux rongeurs se tenait sur la place de l’Hôtel de ville. »[41]. Puis, deux jours plus tard : « Je signale l’ouverture, cette semaine, des boucheries de viande de chien et de viande de chat et de rats. Ces derniers se mangent de préférence en pâté. »[42].
Francis Wey s’amuse à recopier un menu « qui a fait le tour des salons » : «
Consommé de cheval au millet. RELEVÉS : Brochettes de foies de chien à la maître
d'hôtel. Émincés de râble de chat sauce mayonnaise. « ENTRÉES : Épaule et filet de chien braisé sauce tomates. Civet de chat aux champignons. Côtelettes de chien aux petits pois. Salmis de rats à
la Robert. ROTS : Gigot de chien flanqué de ratons. Salade d'escarolles. LÉGUMES : Bégonia au jus. Plum-pudding au jus et à la moelle de cheval. Dessert et vins. »[43] Et livre son opinion : « Remarquons toutefois
que les nourritures bizarres,
empruntées aux animaux
domestiques ou immondes, étaient encore des curiosités gastronomiques plutôt que des ressources nécessaires. Paris se fait de tout une amusette, et le beau monde tenait à se flatter un jour d'avoir mangé des caniches et des rats. Quant au bon peuple, il mourrait… »[44].
Plus couramment, Lisagaray écrit : « La faim piquait plus dur d’heure en heure. La viande de cheval devenait une délicatesse. On dévorait les chiens, les chats et les rats. »[45].
Au 9 octobre, J. H. Paradis relève le prix des filets de bœuf et jambon : « de 3 à 6 francs » et du rosbif : « 3francs »[46]. Au 5 décembre, il note ces prix : « Gigot de chien, 2 fr la livre ; rognons, 25 centimes la pièce ; un chat dépouillé de sa peau vaut 5 fr. »[47]. Au 25 décembre, il consigne : « poulet 35 fr ; chat : 20 fr »[48].
Si on peut estimer le salaire moyen d’un ouvrier à Paris à 5 francs par jour[49] et celui de l’ouvrière à 2,25 francs[50], pendant le Siège le travail manque, beaucoup ne vivent que de la solde de garde national, ou de la pension de veuve, qu’ils reçoivent. Cette solde est de 30 sous[51], soit 1 franc 50[52].]
Mais surtout c’est ce froid, dès début décembre[53] qui rend les choses douloureuses… Fin décembre, le bois se fait si rare, qu’« on ne fait plus de feu que dans une seule chambre, qui devient la chambre commune. »[54]. Mi-Janvier, « voilà vingt jours qu’il gèle sans discontinuer ; ce qui ne s’est presque jamais vu à Paris. »[55]. On ouvre des chauffoirs publics, où les plus pauvres peuvent venir manger et les femmes coudre[56]… Avec la malnutrition, le froid rend les mois de Décembre et de Janvier meurtriers. Le taux de mortalité double[57]. On meurt de variole, de scarlatine, de rougeole, de fièvre typhoïde, de bronchite ou de pneumonie[58]…
[Noter que la population participe aux souscriptions nationales pour acheter des canons. Au 10 novembre, par exemple, la somme atteint un million cinq cent mille cinquante francs[59].
Début janvier, Paris est bombardé. On se réfugie dans les caves[60]. Le 10 janvier, « Paris n’a pas fermé l’œil un seul instant cette nuit »[61], effrayé par le bruit déchirant des bombes. Cette sensation-là que, chez soi, dans sa tranquillité, le feu puisse venir vous trouver et vous abattre, à tout instant, dans sa soudaineté et son imprévisibilité injustes, cruelles, je crois qu’on ne saurait pas la décrire.
Et puis, à la fin Janvier, « le froid a disparu »[62]… Quelques jours plus tard, l’armistice est signé. Le 27 Janvier, c’est la première fois depuis plus d’un mois qu’on passe la journée « sans entendre le bruit terrible du canon »[63]. La rigueur va se faire plus lâche, les vivres vont circuler et les gens, les amis, la famille restés loin en Province… On va pouvoir leur écrire, les revoir, retrouver ce qui fait qu’on les reconnaît toujours, l’éclat de leurs yeux, la caresse de leurs voix, la chaleur de leurs corps quand on les serre assez longtemps pour qu’elle perce nos propres chairs et nous ensuque… On n’en revient pas, Paris a tenu… Ce peuple parisien, décidément, quand même !
Dimanche prochain, on regardera l’aspect politicien, les tensions, les querelles…
Voir le site du film "Commune"...
[1] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, Paris, 1872, p. 2.
[2] Ibid., p. 15.
[3] Cf. la fiche Wikipedia Siège de Paris (1870), version en date du 24 juillet 2013.
[4] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, op. cit., p. 14.
[5] In Émile Zola, l’Assommoir.
[6] Augustine M. Blanchecotte, Tablettes d’une femme pendant la Commune, Paris, 1872, p. 55.
[7] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, ibid..
[8] Ibid., p. 16.
[9] Ibid., p. 11.
[10] Ibid., p. 2.
[11] Ibid., p. 49.
[12] Ibid., p. 56.
[13] Ibid., p. 155.
[14] Ibid., p. 51.
[15] Ibid., p. 63.
[16] Ibid., p. 516.
[17] Ibid., p. 136.
[18] Ibid., p. 526.
[19] Ibid., p. 108.
[20] Ibid., p. 173.
[21] Ibid., p. 252.
[22] Ibid., p. 321.
[23] Ibid., p. 580.
[24] Ibid., p. 11.
[25] Ibid., p. 11.
[26] Ibid., p. 224.
[27] Ibid., p. 121.
[28] Ibid., p. 218.
[29] Ibid., p. 121.
[30] Ibid., p. 321.
[31] Ibid., p. 243.
[32] Ibid., p. 425.
[33] Ibid., p. 425.
[34] Ibid., p. 425.
[35] Ibid., p. 834.
[36] Ibid., p. 872.
[37] Ibid., p. 496.
[38] Ibid., p. 582.
[39] Ibid., p. 389.
[40] In Frank Schloesser, les Menus du siège 1870-1871, numérisé par la médiathèque de Lisieux, www.bmlisieux.com/curiosa/schloe01.htm.
[41] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, op. cit., p. 350.
[42] Ibid., p. 355.
[43] Francis Wey, Chronique du Siège de Paris, ed Hachette, p. 219.
[44] Ibid., p. 218.
[45] Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, 1929, p. 60.
[46] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, op. cit., p. 121.
[47] Ibid., p. 464.
[48] Ibid., p. 550.
[49] Cf. Paul Louis, Histoire de la classe ouvrière en France de la Révolution à nos Jours.
[50] Jeanne Gaillard, Paris, la Ville (1852-1870), éd. L’Harmattan, 1997, p. 294.
[51] Cf. par ex le journal des Goncourt, T. II, vendredi 7 octobre : « le pauvre diable sollicite son admission dans la garde nationale, pour gagner 30 sous par jour ».
[52] “la solde d’un garde national se monte à 1,50 francs par jour (2 francs pour les sous-officiers et 2,50 francs pour les officiers) » in Eric Cavaterra, la Banque de France et la Commune de Paris, ed. L’Harmattan, p. 42.
[53] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, op. cit., p. 480.
[54] Ibid., p. 563.
[55] Ibid., p. 766.
[56] Ibid., p. 824.
[57] Cf. la fiche Wikipedia Siège de Paris (1870), version en date du 24 juillet 2013.
[58] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, op. cit., p. 684.
[59] Ibid., p. 348.
[60] Ibid., p. 694.
[61] Ibid., p. 707.
[62] Ibid., p. 775.
[63] Ibid., p. 878.